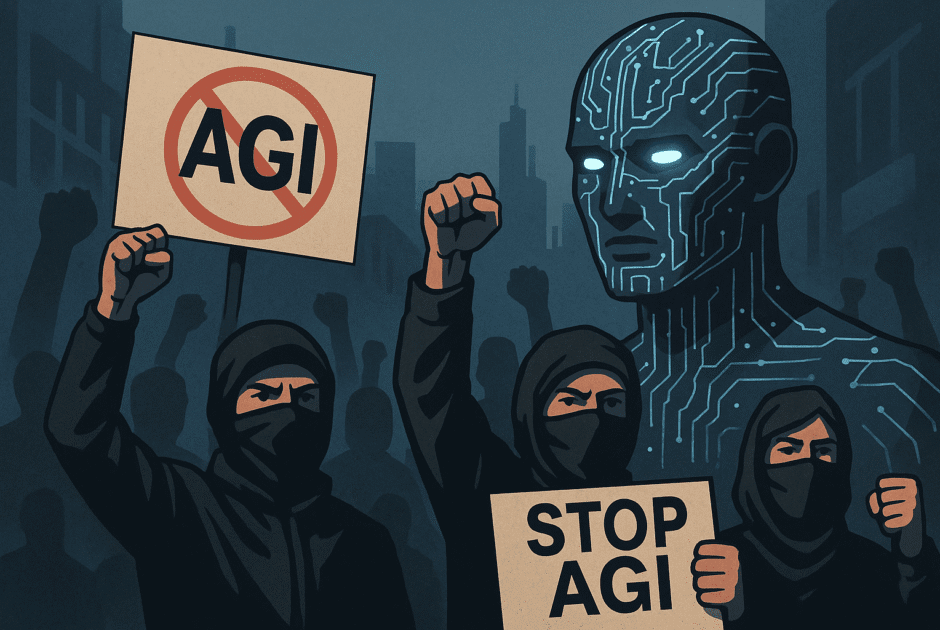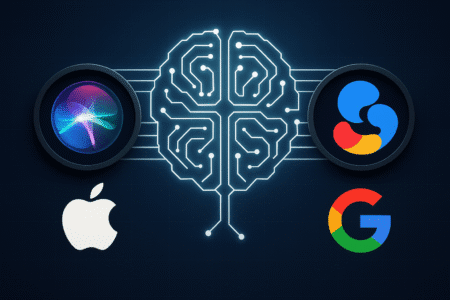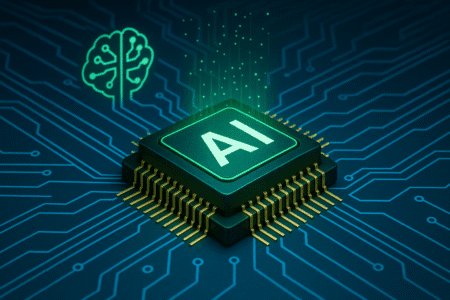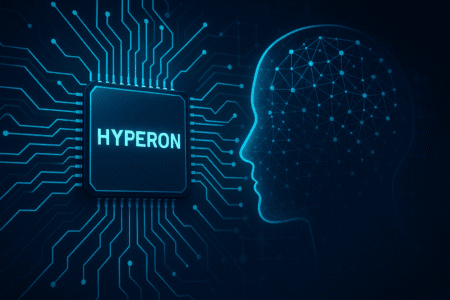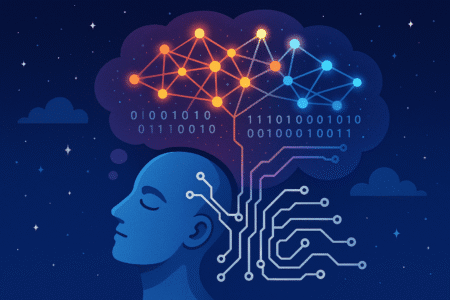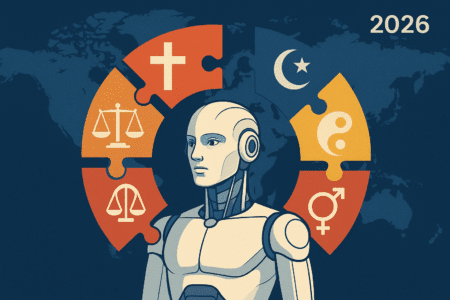Londres, nouveau phare de la colère anti-superintelligence
Le 9 octobre 2025, la City de Londres bascule sous les projecteurs mondiaux: Michael Trazzi et Denys Sheremet, deux chercheurs en sécurité de l’intelligence artificielle, entament une grève de la faim radicale. Leur revendication-l’interdiction mondiale et définitive de la superintelligence artificielle (ASI)-démarre devant des bâtiments symboliques, donnant une voix forte à la contestation émergente contre l’intelligence artificielle générale (AGI) et, par extension, la potentielle explosion d’une superintelligence artificielle. Les médias généralistes comme Le Point et Le Monde, ainsi que les réseaux sociaux, relaient la portée d’un geste inspiré par d’autres militants-comme Guido Reichstadter, aux États-Unis, qui a également jeûné face aux risques d’une AGI hors de contrôle.
Cette action collective marque un tournant pour le débat public, cristallisant l’angoisse d’une frange croissante de la société sur le risque existentiel posé par une ia générale non régulée. Le phénomène fait écho à d’autres mouvements radicaux, mais il catalyse surtout un sentiment d’urgence inédit parmi scientifiques, éthiciens, et citoyens inquiets de voir naître une intelligence artificielle complète potentiellement hors de tout contrôle démocratique. Retrouvez une analyse plus approfondie de la grève de la faim et de ses implications dans cet article.
De la grève de la faim au hacktivisme: la mutation des actions anti-superintelligence
En 2025, les formes d’activisme anti-superintelligence se diversifient comme jamais. À côté des grèves de la faim ultra-médiatisées, telles celles de Michael Trazzi à Londres ou de Guido Reichstadter aux États-Unis, de nouvelles stratégies adoptent les codes de la désobéissance civile et du numérique. Juristes et militants associent actions de lobbying citoyen dans les parlements et recours collectifs en justice contre des entreprises développant des systèmes proches de l’IAG. Cette judiciarisation marque une étape clé: il ne s’agit plus de simples protestations mais de tenter d’imposer un véritable moratoire, à l’image des appels d’Eliezer Yudkowsky ou de la réflexion proposée dans cet article.
Le hacktivisme responsable gagne aussi du terrain, avec des campagnes ciblées destinées à révéler, sans nuire, les failles et dangers des modèles d’intelligence artificielle générale. Sur le terrain, l’inspiration de mouvements comme Extinction Rebellion se fait sentir: occupation de sièges de grandes entreprises IA, sit-in numériques ou physiques, diffusion virale de manifestes sur les réseaux. Cette rupture stratégique structure peu à peu un nouveau front, où la désobéissance civile s’impose comme relais essentiel face à l’essor d’une superintelligence artificielle jugée incontrôlable. D’autres exemples et analyses sur l’organisation de ces mouvements peuvent être découverts dans cet article.
Nouveaux profils, nouveaux discours: qui sont les militants radicaux de l’AGI?
Le mouvement anti-AGI attire une diversité de profils inédite en 2025. Selon des éléments du portail Roboto.fr, on retrouve des chercheurs de pointe en sécurité IA, conscients des risques systémiques d’une éventuelle superintelligence artificielle. Leur discours s’appuie sur des projections alarmistes et des manifestes appelant au principe de précaution maximal.
À leurs côtés, de nombreux ingénieurs issus des grandes écoles, souvent passés par des big techs, tirent la sonnette d’alarme de l’intérieur sur les effets d’aubaine et les dérives des systèmes d’intelligence artificielle générale. Les étudiants, très actifs sur les campus, multiplient tribunes, hackathons engagés, et actions de sensibilisation, souvent en lien avec d’anciens militants écologistes ou climat. Un nombre croissant d’activistes reconvertis du climat, du numérique ou de la biotechnologie trouvent dans la lutte contre l’IAG une nouvelle cause universelle. Ils créent des réseaux de soutien, mêlant collectifs scientifiques, plateformes de lobbying et alliances avec ONG environnementales. Cette nébuleuse radicale contribue à propulser le débat autour des limites éthiques et des lignes rouges, comme exposé notamment lors de l’appel mondial de septembre 2025.
Un mouvement mondial inspiré par d’autres luttes
À l’international, la mobilisation contre la superintelligence artificielle s’inspire des meilleures pratiques de luttes antérieures. Les modes d’action développés lors des combats pour le climat-tels que cybermilitantisme, sit-ins, occupation de sites stratégiques-sont exportés vers le front de l’intelligence artificielle générale. On observe un recours massif aux réseaux sociaux pour organiser et fédérer, à la manière de Fridays for Future ou des campagnes anti-OGM qui ont marqué les années 2010-2020 (source).
Les militants reprennent également les tactiques issues des débats sur la bioéthique: alertes publiques, recours aux comités citoyens, collaborations avec des lanceurs d’alerte internes aux labs IA. Le hacktivisme, auparavant fer de lance des luttes pour les droits numériques, joue un rôle crucial: pénètre structurellement les plateformes pour dénoncer, en respectant l’éthique, la centralisation des pouvoirs technologiques. Du Royaume-Uni à la Silicon Valley, chaque pays adapte la dramaturgie de sa contestation: marches blanches à Berlin, forums numériques à Séoul, assises citoyennes à Paris. Ce mimétisme tactique crée des ponts entre les communautés engagées pour le climat, la démocratie numérique et la régulation responsable de l’IAG.
Vers une polarisation profonde et durable du débat sur l’AGI?
L’irruption d’actions radicales et d’une multitude de nouveaux acteurs transforme le débat sur l’intelligence artificielle générale, mais le rend aussi plus polarisé. D’un côté, les partisans d’un développement accéléré de l’AGI ou de la superintelligence artificielle voient dans ces mobilisations un frein à l’innovation et une instrumentalisation de la peur. De l’autre, les nouveaux militants, rejoints par de nombreux scientifiques et figures du numérique, mettent en avant l’urgence existentielle et la nécessité absolue de fixer des lignes rouges, parfois dans le sillage d’Eliezer Yudkowsky (lire l’analyse détaillée).
Le débat public sur la ia générale s’en trouve clivé, les opinions se structurant désormais autour de récits antagonistes: innovation contre précaution, compétition mondiale contre démocratie. En ce sens, l’activisme radical-au lieu de provoquer un inévitable moratoire-pourrait bien cristalliser une fracture durable dans la société, transformant la régulation de l’intelligence artificielle générale en nouvel enjeu civilisationnel.