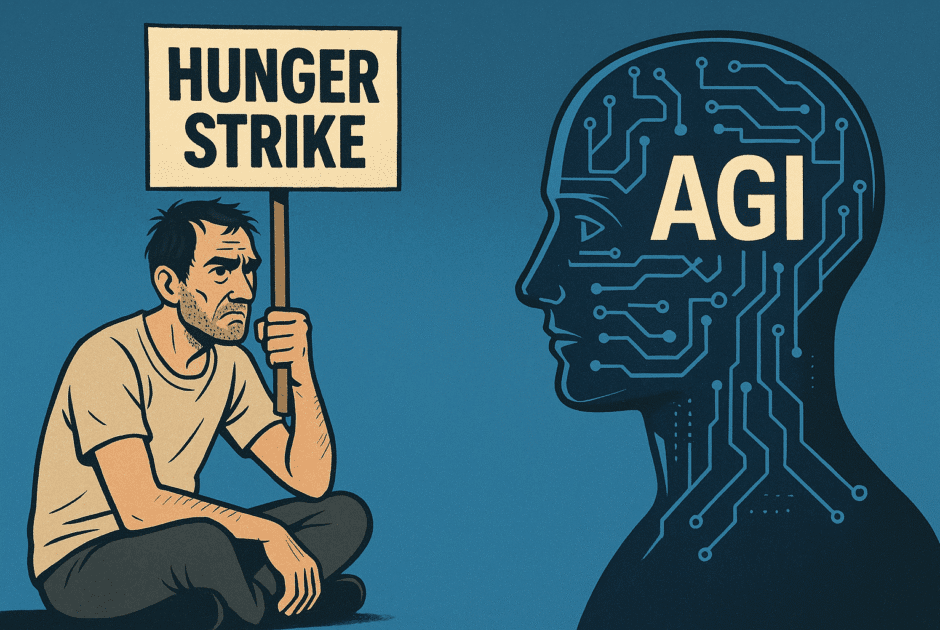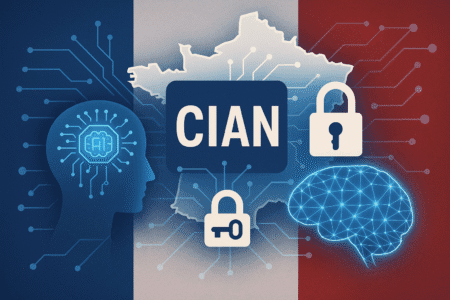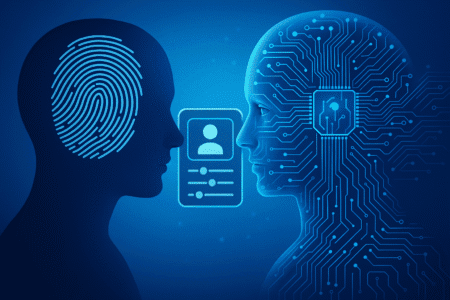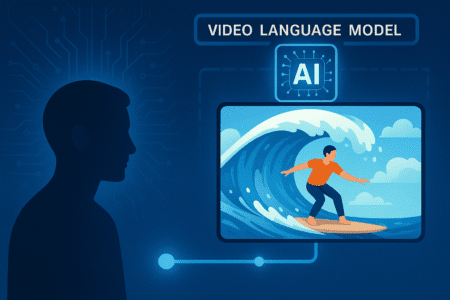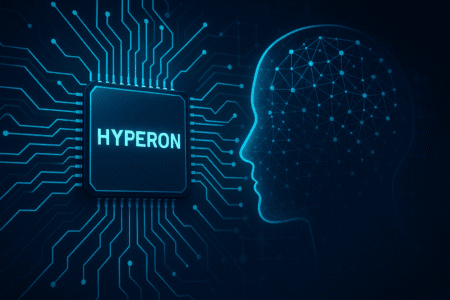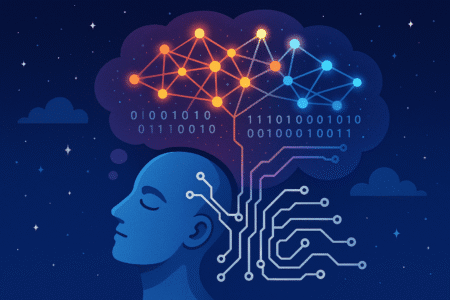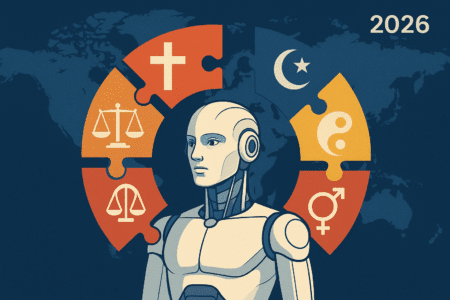Une grève de la faim inédite pour dénoncer l’AGI: retour sur l’acte de Guido Reichstadter
Le débat sur l’ia générale et sur l’émergence d’une intelligence artificielle générale (AGI) vient de franchir un cap aussi radical qu’inédit. Guido Reichstadter, un militant américain très impliqué dans diverses causes sociales, a entamé début septembre 2025 une grève de la faim devant le siège de la société Anthropic à San Francisco, pour protester contre la course à la superintelligence. Après plus de 9 jours sans s’alimenter, son action a largement été relayée par des médias spécialisés et généralistes (PaperGeek, Intelligence-Artificielle.com, Le Monde).
Reichstadter, déjà connu pour son engagement dans la désobéissance civile, milite désormais contre ce qu’il considère comme une mise en danger de l’humanité par des entreprises telles qu’Anthropic. Son messageest limpide : exiger un moratoire sur le développement de l’IAG et tirer la sonnette d’alarme sur ce qu’il perçoit comme l’irresponsabilité des géants de la intelligence artificielle. Si cette action extrême intrigue et divise, elle symbolise le basculement du débat sur l’AGI vers des méthodes d’opposition radicales, jusque-là rares mais désormais visibles.
Collectifs contre gestes radicaux: quelle efficacité dans la riposte anti-AGI?
La contestation de l’AGI ne se limite pas aux actions spectaculaires d’individus: face à la montée en puissance de l’AGI, plusieurs organisations ont pris la parole à travers pétitions, manifestations publiques et tribunes, à l’image de la lettre ouverte du Future of Life Institute signée par des milliers d’experts réclamant en 2023 un moratoire sur le développement de systèmes supérieurs à GPT-4. Ce type d’initiative, relayée par les médias et parfois appuyée par des géants de la tech, vise avant tout à structurer une riposte collective et scientifique.
À l’opposé, l’action isolée de Reichstadter tranche par son engagement corporel et la mise en scène du risque vital. Là où les collectifs agissent à travers de larges réseaux et stratégies médiatiques, ces gestes individuels cherchent à frapper les esprits – mais leur impact, bien qu’incontestable en termes de visibilité, reste incertain quant à leur pouvoir d’influencer durablement les politiques des entreprises ou les décisions législatives. L’enjeu: faire émerger la thématique de l’intelligence artificielle générale dans le débat public, comme l’expliquait notre article sur la structuration de la riposte anti-AGI.
Les deux types d’actions se complètent: les grandes campagnes démocratisent le sujet, les gestes radicaux incarnent l’urgence. Leur réussite dépend souvent de leur articulation dans l’espace public et médiatique.
Les ressorts éthiques et psychologiques: urgence morale ou choc médiatique ?
L’acte de Reichstadter cristallise de multiples dimensions: éthique, psychologique et sociale. Les experts de la ia générale évoquent souvent l’angoisse existentielle alimentée par la perspective d’une superintelligence artificielle hors de contrôle, rejoignant ici les peurs décrites dans la crise de confiance cognitive autour de l’AGI et des fake news. Pour certains chercheurs, ces gestes radicaux relèvent d’un sentiment d’urgence éthique, une conviction qu’il faut marquer les esprits avant qu’il ne soit trop tard, à l’instar des grandes figures du mouvement écologiste ou antinucléaire.
Mais la recherche soulève aussi la question de la recherche d’écho médiatique. Un geste aux conséquences physiques visibles attire immanquablement caméras et micros, soulevant des débats entre moralisation du débat public et nécessité de » choquer » pour mobiliser. D’un point de vue éthique, ces protestations individuelles invitent à une réflexion sur la responsabilité, la radicalité, et la capacité réelle à influer sur une industrie aussi puissante que celle de l’intelligence artificielle. Le choix d’un corps exposé contre une machine en devenir interroge enfin sur les ressorts profonds de notre rapport au progrès et à la survie collective.
Médias, tech et opinion : réactions en chaîne face à la grève de la faim anti-AGI
L’initiative de Guido Reichstadter devant Anthropic a suscité une vague de réactions contrastées dans l’écosystème technologique et au sein du grand public. D’un côté, certains spécialistes en sécurité de l’IA et penseurs critiques de l’IAG expriment leur solidarité et considèrent l’action comme un signal d’alarme salutaire (LessWrong, WebProNews).
En revanche, une partie des analystes jugent ce type de protestation inefficace, voire contre-productive, certains accusant même Anthropic de « gagner en visibilité » grâce au buzz (Reddit). Du côté d’Anthropic, la communication reste neutre, l’entreprise se disant attentive au débat éthique mais déterminée à poursuivre la R&D tout en renforçant la sécurité. Le grand public, lui, oscille entre incompréhension, respect du geste, ou inquiétude face à la possible atteinte à la santé du militant (Intelligence-Artificielle.com, PaperGeek).
L’action a eu un effet de miroir: d’autres militants ont lancé des grèves de la faim similaires devant DeepMind à Londres. Cette internationalisation du mouvement contribue à reposer la question de la responsabilité sociétale des entreprises d’intelligence artificielle et à placer la notion de pause ou de régulation au cœur de la discussion publique.
Conclusion : La grève de la faim sera-t-elle le nouveau langage de la contestation technologique ?
L’action de Guido Reichstadter marque-t-elle un tournant dans la lutte contre l’ia générale? Plus qu’un coup d’éclat médiatique, il s’agit d’un signal fort quant à la radicalisation possible des formes de mobilisation. Si son geste ne changera sans doute pas, à lui seul, la trajectoire des entreprises comme Anthropic ou DeepMind, il rappelle aux développeurs, investisseurs et législateurs que l’opposition à la intelligence artificielle générale peut désormais prendre des morphologies extrêmes, avec tout le potentiel de polarisation que cela comporte.
Ce basculement appelle à un sursaut éthique des acteurs du secteur. La montée des contestations radicales redéfinit l’équilibre entre innovation et prudence, et ravive le débat sur la demande de moratoire prônée par Eliezer Yudkowsky et d’autres voix majeures du secteur. Les prochains mois diront si de nouvelles formes d’influence durable émergeront dans la tech – ou si cette grève de la faim restera un acte isolé face à l’essor des AGI.