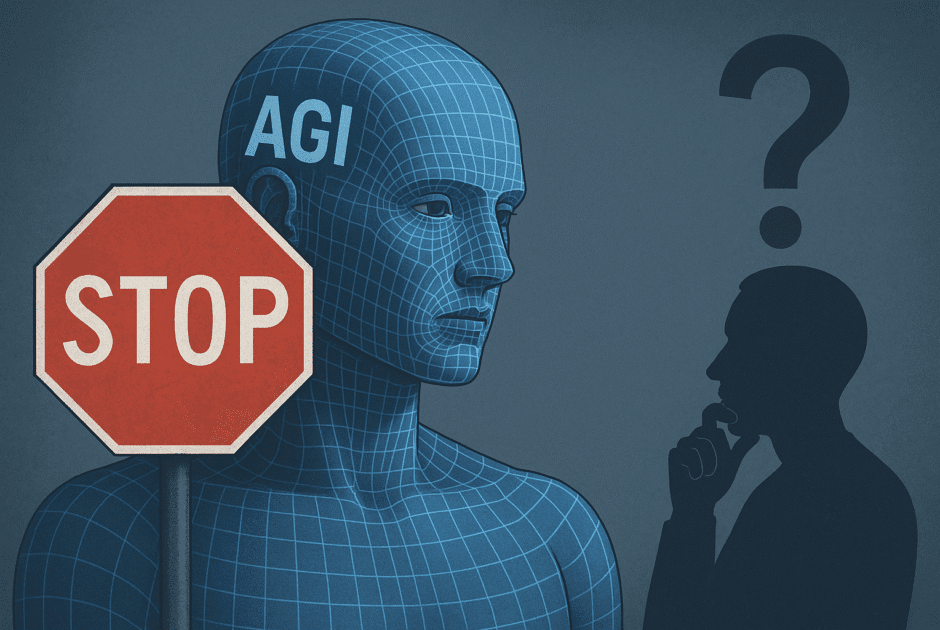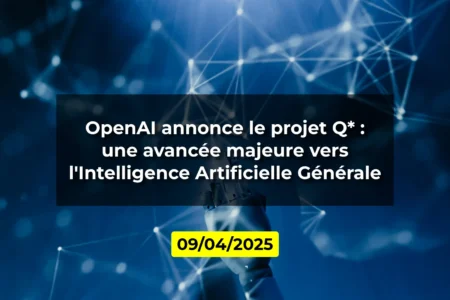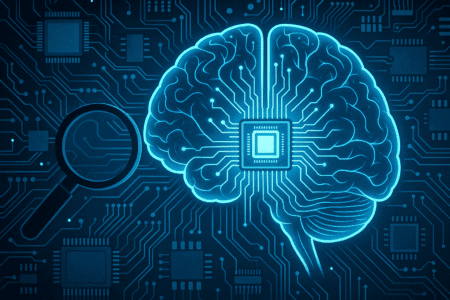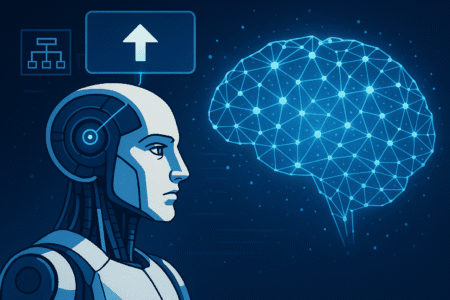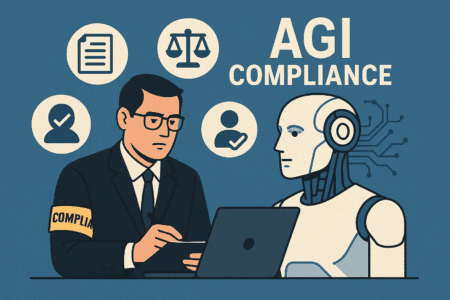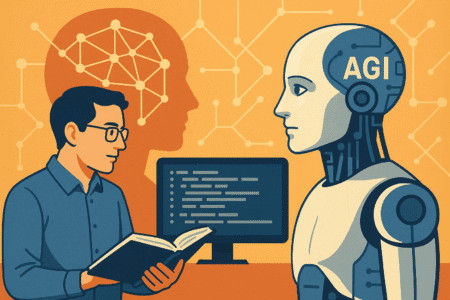Scepticisme grandissant : la promesse de l’AGI remise en cause
Depuis la vague d’enthousiasme autour de l’intelligence artificielle générale (AGI) en début de décennie, les perceptions ont évolué vers une remise en question franche et argumentée des progrès réalisés. En 2025, une pluralité de voix critiques s’élève dans la tech et la recherche, soulignant la stagnation et les limites des modèles actuels, principalement issus du deep learning. Des figures comme Yann LeCun rappellent que l’intelligence humaine ne se limite pas à l’accumulation d’énormes jeux de données ou à la prédiction probabiliste, pointant les lacunes en matière de compréhension du réel et de raisonnement abstrait.
Sur le forum Reddit r/singularity (source), des chercheurs évoquent la fatigue conceptuelle : le manque d’idées nouvelles et de pistes innovantes freine le franchissement du cap vers une véritable ia générale. Les médias spécialisés comme Xpert Digital mettent en avant les difficultés rencontrées par les systèmes actuels à performer sur des benchmarks exigeant un raisonnement avancé, malgré les annonces régulières de percées spectaculaires.
Dans les conférences et panels, l’agitation provoquée par les promesses non tenues se fait sentir. Les doutes sur la viabilité de l’approche purement statistique s’accumulent, et des analyses récentes (LinuxFr) traduisent la crainte que l’IAG ne soit victime d’un emballement médiatique et financier, nourrissant ainsi une possible » bulle » de l’AGI.
Pour aller plus loin sur la question des signaux faibles et de la veille autour de la bulle IA, découvrez ce dossier de veille stratégique.
Apprendre comme un humain : les vrais verrous de l’IA forte
Les obstacles à l’intelligence artificielle forte, ou intelligence artificielle générale, résident dans la difficulté à reproduire certains traits cognitifs fondamentaux. Là où les modèles d’IA modulaire excellent dans des tâches spécialisées, l’AGI devrait intégrer:
- Une mémoire de long terme efficace, contextuelle, semblable à la mémoire humaine, capable de mise à jour continue.
- Un apprentissage continu, c’est-à-dire évoluer sans être « re-initialisé », comme exposé lors du colloque international sur l’apprentissage (2025).
- La plasticité cognitive, qui permet à l’humain d’adapter ses connexions neuronales à chaque expérience vécue (Plasticité 2025).
- L’autonomie réelle dans la prise d’initiative et la gestion d’objectifs complexes, sans supervision humaine explicite.
- La compréhension fine du contexte, au cœur de la cognition humaine, encore loin d’être atteinte (UNESCO).
Pour l’instant, toutes ces caractéristiques restent très difficiles à modéliser. L’IA générale souffre encore de cycles courts de mémoire et d’un » effet boîte noire » rendant l’évolution des modèles difficilement transparente ou contrôlable. De plus, la capacité d’apprendre en continu sans » effondrement catastrophique » (oubli des anciens savoirs lors de nouveaux apprentissages) demeure limitée. Les débats lors des événements majeurs comme le Colloque du Collège de France confirment combien ces verrous structurent l’agenda des chercheurs.
Pour approfondir les enjeux cognitifs de l’AGI, lisez aussi cet article sur les hallucinations IA.
Conséquences pour la recherche et les laboratoires IA en 2025
Face à ce scepticisme, les grands laboratoires de recherche réévaluent leurs stratégies et revoient leurs roadmaps pour 2025 et au-delà. De plus en plus, ils explorent l’hybridation entre différentes approches de l’intelligence artificielle : deep learning, symbolisme, méthodes bayésiennes, et surtout, des architectures inspirées du vivant (La Criée, FocusLab Biomimétisme).
Des discussions lors des forums tels que VivaTech 2025 mettent en lumière les débats internes : faut-il poursuivre la fuite en avant sur le modèle statistique ou ouvrir plus largement aux neurosciences, à la théorie biologique, voire à la robotique incarnée? Les projets de la recherche académique française abondent dans ce sens, misant sur une IA plus explicable et robuste, voire capable de synergies homme-machine approfondies.
Ces évolutions ne sont pas sans conséquences pour le financement, qui devient plus sélectif mais aussi plus exigeant face au manque de percées décisives. Enfin, les think tanks technologiques et éthiques, tout comme les laboratoires publics, discutent désormais ouvertement des limites actuelles et des nécessités d’inventer de nouveaux paradigmes. Un débat documenté dans cet article sur la crise de l’exactitude en IA.
Investisseurs et opinion publique : une bulle d’attente et de défiance?
L’année 2025 voit éclater au grand jour les tensions entre attentes surdimensionnées autour de l’IA générale, déconvenues économiques et défiance croissante des marchés. Études et analyses convergent: plus de 95% des projets pilotes d’IA générative échouent à livrer la valeur promise (MIT, 2025). Cette inefficacité minée par les effets d’annonce accentue la thèse d’une bulle spéculative entretenue par la surévaluation des sociétés liées à l’IAG (Le Grand Continent, Le Figaro).
Le moral des investisseurs est en berne : même Sam Altman, leader emblématique, admet l’existence d’une bulle gonflée par une « surexcitation » (Developpez.com). Du côté du grand public, la « trough of disillusionment » (creux de la désillusion) se traduit par une défiance accrue et un débat critique sur la place de l’AGI dans la société (article de référence).
Dans le monde académique et éthique, cette désillusion alimente les appels à davantage de transparence, de rigueur scientifique, et à un nouveau contrat social autour des promesses de l’intelligence artificielle générale. Pour une analyse stratégique détaillée, consultez cette enquête de La Tribune.
Conclusion : Vers une « pause cognitive » ou un rebond?
La conjoncture de 2025 force à dresser un constat tempéré, voire prudent, sur la trajectoire de l’intelligence artificielle générale. D’un côté, l’écosystème apparaît en pleine phase de pause cognitive, hésitant à reproduire les recettes passées qui n’ont pas permis le passage à l’IA générale. De l’autre, les défis ouverts, tels que la mémoire de long terme, l’autonomie et la compréhension contextuelle, imposent une véritable remise à plat des fondements techniques et épistémologiques.
Le rebond – s’il vient – naîtra sans doute d’un saut de paradigme: hybridation des méthodes, enrichissement par la biologie computationnelle, démocratisation de nouveaux modèles cognitifs. Les débats ouverts lors de grands forums montrent toutefois une évolution bénéfique : la critique devient moteur d’innovation, poussant la communauté à davantage d’humilité et de questionnements éthiques. Les pistes prometteuses résident dans une IA plus explicable, mieux intégrée à la prise de décision humaine, et réconciliée avec ses limites. Un débat qu’il faudra suivre de près aux côtés des questionnements sur la superintelligence artificielle et la place de l’IAG dans nos sociétés.
Pour une vision détaillée de ce climat, consultez l’analyse de Yann LeCun sur les failles de l’AGI.